Le Canal de la Souloise
Article de Gérald ROUX
Les informations de cet article sont issues
d’un fascicule réalisé par Pierre ODDOS de Pellafol. Il a été édité en février
2012 par l’association du Patrimoine de Pellafol. Merci Pierre !
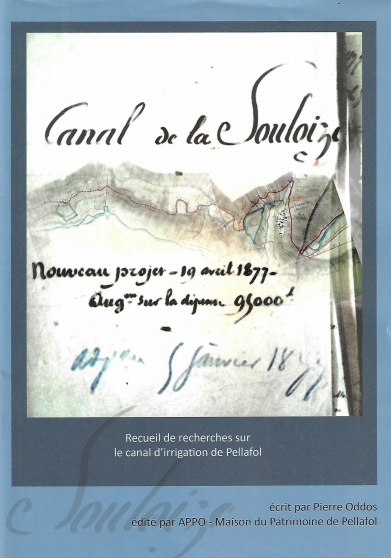
Origine
Vu le travail gigantesque de ce canal que
certains attribuent aux Romains (!), Pierre ODDOS soulève la question de la
nécessité de l’ouvrage.
La position de Pellafol lui donne un climat
méditerranéen l’été avec un manque d’eau l’été. Les terrains sont des alluvions
glaciaires et donc assez poreux, ne retenant pas l’eau. L’exode rural commence
en 1840 avec l’industrialisation et la commune n’arrive pas à nourrir sa
population (100 habitants de moins entre 1866 et 1872 !). La réalisation du canal du Beaumont donne des
idées.
Tout ceci conduit la commune le 15/8/1863 à
demander l’étude d’un canal qui permettrait d’arroser 4 à 500ha de terres
Enquête publique 1869-1870
Il apparait surtout que 3 moulins à blé de la
commune de St Disdier vont s’arrêter de tourner. Pas de problème avec celui de
la Posterle alimenté par les Gillardes
(vous en voyez les ruines au bord de la Souloise à la
hauteur de la Posterle, c’est celui de Hilaire
Baptiste CATALAN, 1852-1925, né au moulin en 1852 et de son père Jacques.
Hilaire est l’arrière-grand-père des CATALAN qui ont encore 2 maisons à la Posterle).

Les négociations : 1875 -1877
Le décret d’utilité publique permet
d’exproprier les terrains nécessaires, assez peu en fait. Le plus gros sujet a
été de convaincre la commune de Saint Disdier d’autoriser à prendre l’eau. Cela
a été obtenu quand Pellafol a cédé 200 ha de bois dans le Sappey
à ses voisins du Dévoluy qui avaient beaucoup déforesté. L’autre obstacle à lever
a été le Moulin de Casimir CATELAN à St Disdier racheté le 16/3/1877 (on
ne sait pas s’il est de la même famille que les CATALAN, meunier de la Posterle).
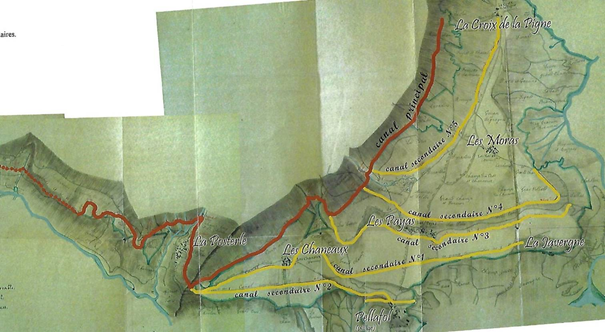
Les Travaux 1875-1880
Il s’agit de capter l’eau à St Disdier à 1020m
d’altitude, pour l’amener par un canal de 8km à 0,5% de pente au-dessus du
plateau de Pellafol, jusqu’à la Croix de la Pigne. Pierre ODDOS
analyse :
De grosses difficultés pour créer le captage
dans les rochers sous le hameau des jouves.
Puis longue traversée dans la paroi rocheuse
jusqu’au Sappey nécéssitant
une suite de tunnels et d’encorbellements. Il reste forcément visible de la
route avec sa largeur inférieure à 1,20m et ses galeries de hauteur
1,70m : des difficultés considérables…
Il faut ensuite un aqueduc pour passer le
ruisseau de la Posterle et enfin traverser une
gravière instable de 2400 mètres.
Les ouvriers
Ils gagnent 2 francs par jour et un litre de
vin. Le travail est dangereux. Pierre ODDOS cite au moins 4 décés
dans la commune de Pellafol :
26/8/1875 Jean Jacques GAUDE 21 ans,
5/4/1878 Giuseppe ANESA, 20 ans,
20/6/1878 Luigi MAGNI, 26 ans
10/8/1879 M Ré,
Nota : le décés de
Luigi MAGNI n’est peut-être pas accidentel mais pourrait se rapporter à
l’article retrouvé par Cyril ROYER dans un journal de 1878 racontant un
assassinat à la Posterle par un aubergiste qui
hébergeait des ouvriers
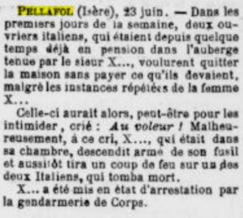

J’ai repris 2 photos sur internet : il y
en a de nombreuses et spectaculaire en cherchant « canal de
Pellafol » dans images de google.
Le financement
Le Coût est de 222 000 Francs, dont 1/3
financé par l’état. La commune de Pellafol accorde 45 000 Francs de
subvention. Le syndicat du canal emprunte 172 500 Francs par obligations
de 1000 F à 4%. Les recettes seront une taxe de 36 F par hectare arrosée et par
an pour les membres du syndicat. Les obligations seront remboursées par tirage
au sort jusqu’en 1926.
Le fonctionnement du canal
Il sera chaotique, émaillé de nombreux procès
et problèmes techniques. D’abord parce que les adhérents sont pauvres et que
les taxes sont toujours au minimum. Ensuite des fuites, des éboulements, des
manques d’eau créent de grosses dissensions dans le syndicat. A la lecture du
fascicule de Pierre ODDOS plusieurs familles de Pellafol retrouveront des
membres de leurs familles mentionnés…
Les béaliers
Ce mot vient de l’occitan Béal
pour un petit canal. A Pellafol on appelle aussi un petit ruisseau un Biaou . J’ai retrouvé l’appellation Béal
pour le petit canal qui dévale au milieu de la rue principale de Saint Martin
Vésubie, comme à Briançon.
Trois béaliers sont
embauchés au début puis seulement deux. Leur travail est délicat car ils gèrent
la distribution d’eau par des vannes qui sont des plaques métalliques
coulissant, à coup de marteau, dans des martelières.
Ils entretiennent, curent et s’assurent que personne ne fraude ! Il y a
des tensions, on accuse un béalier sous funeste
influence de refuser d’obéir au Directeur ...
Les ruines de Pellafol et la fin du canal
Les ruines sont les effondrements de la plaine
de Pellafol dans la vallée de la Souloise. C’est une
érosion intense à la Posterle, aux droit des Chanaux, au Vieux pellafol …
Cette érosion a été intense de 1836 à 1888. En
1889 un formidable effondrement a emporté plusieurs hectares. C’est la source
de l’abandon partiel du Vieux Pellafol dont beaucoup d’habitants ont rejoint le
hameau des Payas.
Le cimetière et l’église ont
disparu : le dernier pan de l’église est tombé au moment de la
guerre de 14-18 ou juste avant. Bien entendu la canal et l’arrosage sont
incriminés. De plus l’eau manque l’été. Tout ceci conduit le syndicat à voter
le 21/9/1890 la suppression de l’utilisation du canal. Mais il va continuer
encore quelques années : on laisse aller sans entretien.
Il fonctionne jusqu’au 10 avril 1910, soit 30
ans en tout. On refuse encore une remise en état demandée en 1911 par un
adhérent. On soldera progressivement les comptes et le syndicat sera dissout en
1927.

Même si la mésentente et l’individualisme ont
été source de difficultés, le phénomène d’érosion a été dominant. Il reste quelques
portions pour faire une jolie balade entre la Posterle
et les Chanaux. Mon grand-père de la Posterle a caché du matériel des résistants dans le canal
pendant la 2eme guerre.
Mon lointain cousin Claude PIOT regrette
que le canal ne soit pas transformé en super balade aussi spectaculaire que
celle du caminito del Rey
en Andalousie. Mais on mesure l’investissement énorme lié à la sécurisation des
encorbellements et tunnels, sans compter les nombreux effondrements…